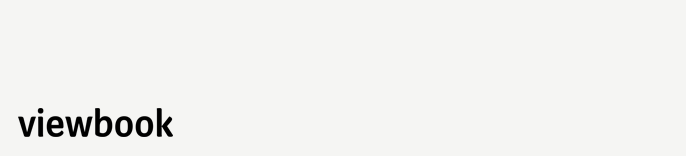Emanuele Coccia
A propos de Fleuves Océans de Nicolas Floc’h
Les fleuves ont toujours été perçus comme la limite absolue de la représentation. Depuis des siècles, ils sont l’incarnation et le symbole de la substance du monde qui ne peut être figée dans une image. Le fleuve a toujours été associé à l’idée de flux : une forme qui n’existe que dans la circulation et la fuite, une figure qui n’acquiert de réalité qu’en se niant elle-même, s’incarnant dans un souvenir ou une anticipation de ce qui s’est passé ou se passera. Le flux est le spectre d’une ressemblance : une image sur laquelle personne ne peut tout à fait se concentrer, une forme qui semble rongée de l’intérieur. S’il est possible d’en faire l’expérience, il est impossible de s’en souvenir ; s’il est possible d’imaginer ce qui va se passer en le voyant, le fait de s’y confronter dissout tout souvenir. Ce n’est pas seulement l’antique logion héraclitéen qui a consacré ce préjugé. C’est, en quelque sorte, la nature même des fleuves qui fait qu’il est difficile de les penser sous la forme d’une image.
En dehors de toute métaphore, en effet, le fleuve reste la plus énigmatique des formes que la matière puisse prendre sur la Terre. Il est fait de la substance la plus essentielle à la vie, celle qui compose majoritairement tous les êtres vivants : l’eau. Pourtant c’est comme si dans les cours d’eau, cette substance venait à exister de la manière opposée à celle par laquelle elle rend la vie possible. Non seulement elle n’a ni stabilité ni forme, mais l’idée même d’attache à un lieu est beaucoup plus vague qu’on ne le pense. Il y a quelques années, l’architecte paysagiste d’origine indienne Dilip da Cunha a souligné l’idée que la représentation commune du fleuve comme une ligne allant d’un endroit à un autre, et celle selon laquelle il constitue une masse d’eau clairement distincte de la terre qu’il traverse, est en fait une pure illusion, produite par un apprentissage visuel. Cet apprentissage, selon da Cunha, « privilégie un moment dans le temps où l’eau ne tombe pas, ne s’infiltre pas, n’imbibe pas l’air, le sol et la végétation, ne s’accumule pas, ne s’évapore pas et ne transpire pas » 1. Ce que nous appelons un fleuve n’est en réalité rien d’autre qu’un milieu humide parcourant le paysage, rendant indissociables la terre et l’eau, la stabilité et la fluidité, le ciel et la terre. « Cette humidité ne s’écoule pas comme l’eau ; elle retient, imbibe, souffle, suinte, interpénètre et transpire, se déplaçant de manière non linéaire et jaillissante vers des réserves d’humidité toujours plus grandes, des réserves qui finissent par devenir océan, une humidité qui englobe tout et ne laisse aucune place à la sécheresse. Il existe différents degrés d’humidité. La mer est très humide, le désert moins. » 2. Da Cunha montre comment, dans l’Antiquité, ce milieu humide était appelé Sinjdu en Inde et Océans dans la Grèce d’Homère, « une omniprésence qu’il décrit non seulement comme “l’origine de tous les fleuves et de toutes les mers sur Terre, de toutes les sources et de tous les cours d’eau souterrains”, mais aussi comme la “fontaine” des dieux » 3.
Le travail de Nicolas Floc’h explore depuis de nombreuses années cet étrange seuil d’indistinction, anticipant intuitivement, comme par magie, l’architecture contemporaine des paysages. Ceci n’est pas un hasard : le paysage lui-même est une notion dont la forme a été construite par l’art. Ce n’est pas non plus un hasard si sa dernière œuvre fait coïncider, comme chez Homère, les univers du fleuve et de l’océan. Par ce geste, Floc’h semble à la fois révolutionner notre conception de la vie fluviale et aquatique sur la Terre, et celle même de la pratique artistique. D’abord, sa quête photographique pour décrire et retracer le fleuve, qui fait se croiser accidentellement un labyrinthe et une immense mer de matière et de formes, aboutit à deux conclusions surprenantes. Les fleuves ne sont pas seulement des lieux de concentration d’eau : c’est comme si l’eau, sous forme de vapeur, d’humidité ou simplement comme une partie du corps de tout être vivant, existait en tout point : dans le ciel, sur le sol, dans et entre les arbres, les oiseaux, les glaciers, les déserts, les villes et les prairies. Penser le cours de l’eau sur Terre, c’est en fait penser aux formes que la vie s’est donnée et à la surface même de la planète – si diverse et changeante. Le fleuve n’est pas plus une entité qui se distingue des autres, qu’il n’est possible de l’isoler de toutes les autres : il n’est pas possible de distinguer un trait à la surface du sol ou de tracer une ligne sur le globe terrestre sans que cela n’engendre de rencontrer et de croiser toutes les autres formes. « Fleuves- océans » n’est que l’expression du fait que, dans le monde, tout s’interpénètre dans un immense souffle.
En revanche, il est plus étonnant de constater que la représentation de l’eau d’un fleuve engendre à chaque fois une révélation chromatique imprévisible de l’image, au sens quasi photographique du terme. L’eau, lorsqu’elle devient fleuve – c’est-à-dire le flux des choses, la vie du monde – n’est ni l’absence de couleur (le diaphane), ni le bleu avec lequel depuis l’enfance on a appris à dessiner les rivières et la mer sur le papier : c’est une irisation infinie de toutes les couleurs, et ensemble leur parfaite traductibilité. Le même fleuve, à quelques centimètres de distance, peut en effet changer de « pantone » : c’est comme s’il était le cœur même de la perception chromatique, comme si le monde considéré comme un fleuve-océan avait la capacité d’être caméléon, au moins pour un moment, et d’incarner à travers toutes les couleurs la lumière, ou mieux, la lumière à travers toutes ses couleurs.
C’est à partir de ce résultat que ce travail – comme l’ensemble des œuvres de Floc’h – semble donner à l’art une tâche nouvelle. Depuis des années, sa pratique s’est engagée dans une nouvelle étape de l’exploration du monde : là où pendant des siècles l’art avait rejeté la représentation du réel pour se rabattre sur la représentation de lui-même et de ses supports, Floc’h a, depuis au moins deux décennies, redynamisé la relation entre le monde et l’art, faisant de ce dernier un instrument d’exploration d’espaces jusqu’alors peu fréquentés – les fonds marins, les eaux troubles des fleuves. Si l’art a pu se renouveler à une époque en faisant sortir les artistes de leurs ateliers, aujourd’hui Floc’h le révolutionne en le faisant sortir des villes, des musées, des jardins, des espaces évidents, et plus encore des entrailles de la planète. Cet artiste explorateur évite cependant toute forme d’exotisme nostalgique et romantique : car ce que l’on trouve au fond des océans comme dans les espaces délaissés de la Terre n’est rien d’autre que le cœur même des images, la capacité infinie qu’ont les couleurs de rendre les choses visibles, de traduire l’un en l’autre. Et c’est la capacité même de l’art de tout transformer en quelque chose de différent et d’inattendu.
A propos de Fleuves Océans de Nicolas Floc’h
Les fleuves ont toujours été perçus comme la limite absolue de la représentation. Depuis des siècles, ils sont l’incarnation et le symbole de la substance du monde qui ne peut être figée dans une image. Le fleuve a toujours été associé à l’idée de flux : une forme qui n’existe que dans la circulation et la fuite, une figure qui n’acquiert de réalité qu’en se niant elle-même, s’incarnant dans un souvenir ou une anticipation de ce qui s’est passé ou se passera. Le flux est le spectre d’une ressemblance : une image sur laquelle personne ne peut tout à fait se concentrer, une forme qui semble rongée de l’intérieur. S’il est possible d’en faire l’expérience, il est impossible de s’en souvenir ; s’il est possible d’imaginer ce qui va se passer en le voyant, le fait de s’y confronter dissout tout souvenir. Ce n’est pas seulement l’antique logion héraclitéen qui a consacré ce préjugé. C’est, en quelque sorte, la nature même des fleuves qui fait qu’il est difficile de les penser sous la forme d’une image.
En dehors de toute métaphore, en effet, le fleuve reste la plus énigmatique des formes que la matière puisse prendre sur la Terre. Il est fait de la substance la plus essentielle à la vie, celle qui compose majoritairement tous les êtres vivants : l’eau. Pourtant c’est comme si dans les cours d’eau, cette substance venait à exister de la manière opposée à celle par laquelle elle rend la vie possible. Non seulement elle n’a ni stabilité ni forme, mais l’idée même d’attache à un lieu est beaucoup plus vague qu’on ne le pense. Il y a quelques années, l’architecte paysagiste d’origine indienne Dilip da Cunha a souligné l’idée que la représentation commune du fleuve comme une ligne allant d’un endroit à un autre, et celle selon laquelle il constitue une masse d’eau clairement distincte de la terre qu’il traverse, est en fait une pure illusion, produite par un apprentissage visuel. Cet apprentissage, selon da Cunha, « privilégie un moment dans le temps où l’eau ne tombe pas, ne s’infiltre pas, n’imbibe pas l’air, le sol et la végétation, ne s’accumule pas, ne s’évapore pas et ne transpire pas » 1. Ce que nous appelons un fleuve n’est en réalité rien d’autre qu’un milieu humide parcourant le paysage, rendant indissociables la terre et l’eau, la stabilité et la fluidité, le ciel et la terre. « Cette humidité ne s’écoule pas comme l’eau ; elle retient, imbibe, souffle, suinte, interpénètre et transpire, se déplaçant de manière non linéaire et jaillissante vers des réserves d’humidité toujours plus grandes, des réserves qui finissent par devenir océan, une humidité qui englobe tout et ne laisse aucune place à la sécheresse. Il existe différents degrés d’humidité. La mer est très humide, le désert moins. » 2. Da Cunha montre comment, dans l’Antiquité, ce milieu humide était appelé Sinjdu en Inde et Océans dans la Grèce d’Homère, « une omniprésence qu’il décrit non seulement comme “l’origine de tous les fleuves et de toutes les mers sur Terre, de toutes les sources et de tous les cours d’eau souterrains”, mais aussi comme la “fontaine” des dieux » 3.
Le travail de Nicolas Floc’h explore depuis de nombreuses années cet étrange seuil d’indistinction, anticipant intuitivement, comme par magie, l’architecture contemporaine des paysages. Ceci n’est pas un hasard : le paysage lui-même est une notion dont la forme a été construite par l’art. Ce n’est pas non plus un hasard si sa dernière œuvre fait coïncider, comme chez Homère, les univers du fleuve et de l’océan. Par ce geste, Floc’h semble à la fois révolutionner notre conception de la vie fluviale et aquatique sur la Terre, et celle même de la pratique artistique. D’abord, sa quête photographique pour décrire et retracer le fleuve, qui fait se croiser accidentellement un labyrinthe et une immense mer de matière et de formes, aboutit à deux conclusions surprenantes. Les fleuves ne sont pas seulement des lieux de concentration d’eau : c’est comme si l’eau, sous forme de vapeur, d’humidité ou simplement comme une partie du corps de tout être vivant, existait en tout point : dans le ciel, sur le sol, dans et entre les arbres, les oiseaux, les glaciers, les déserts, les villes et les prairies. Penser le cours de l’eau sur Terre, c’est en fait penser aux formes que la vie s’est donnée et à la surface même de la planète – si diverse et changeante. Le fleuve n’est pas plus une entité qui se distingue des autres, qu’il n’est possible de l’isoler de toutes les autres : il n’est pas possible de distinguer un trait à la surface du sol ou de tracer une ligne sur le globe terrestre sans que cela n’engendre de rencontrer et de croiser toutes les autres formes. « Fleuves- océans » n’est que l’expression du fait que, dans le monde, tout s’interpénètre dans un immense souffle.
En revanche, il est plus étonnant de constater que la représentation de l’eau d’un fleuve engendre à chaque fois une révélation chromatique imprévisible de l’image, au sens quasi photographique du terme. L’eau, lorsqu’elle devient fleuve – c’est-à-dire le flux des choses, la vie du monde – n’est ni l’absence de couleur (le diaphane), ni le bleu avec lequel depuis l’enfance on a appris à dessiner les rivières et la mer sur le papier : c’est une irisation infinie de toutes les couleurs, et ensemble leur parfaite traductibilité. Le même fleuve, à quelques centimètres de distance, peut en effet changer de « pantone » : c’est comme s’il était le cœur même de la perception chromatique, comme si le monde considéré comme un fleuve-océan avait la capacité d’être caméléon, au moins pour un moment, et d’incarner à travers toutes les couleurs la lumière, ou mieux, la lumière à travers toutes ses couleurs.
C’est à partir de ce résultat que ce travail – comme l’ensemble des œuvres de Floc’h – semble donner à l’art une tâche nouvelle. Depuis des années, sa pratique s’est engagée dans une nouvelle étape de l’exploration du monde : là où pendant des siècles l’art avait rejeté la représentation du réel pour se rabattre sur la représentation de lui-même et de ses supports, Floc’h a, depuis au moins deux décennies, redynamisé la relation entre le monde et l’art, faisant de ce dernier un instrument d’exploration d’espaces jusqu’alors peu fréquentés – les fonds marins, les eaux troubles des fleuves. Si l’art a pu se renouveler à une époque en faisant sortir les artistes de leurs ateliers, aujourd’hui Floc’h le révolutionne en le faisant sortir des villes, des musées, des jardins, des espaces évidents, et plus encore des entrailles de la planète. Cet artiste explorateur évite cependant toute forme d’exotisme nostalgique et romantique : car ce que l’on trouve au fond des océans comme dans les espaces délaissés de la Terre n’est rien d’autre que le cœur même des images, la capacité infinie qu’ont les couleurs de rendre les choses visibles, de traduire l’un en l’autre. Et c’est la capacité même de l’art de tout transformer en quelque chose de différent et d’inattendu.